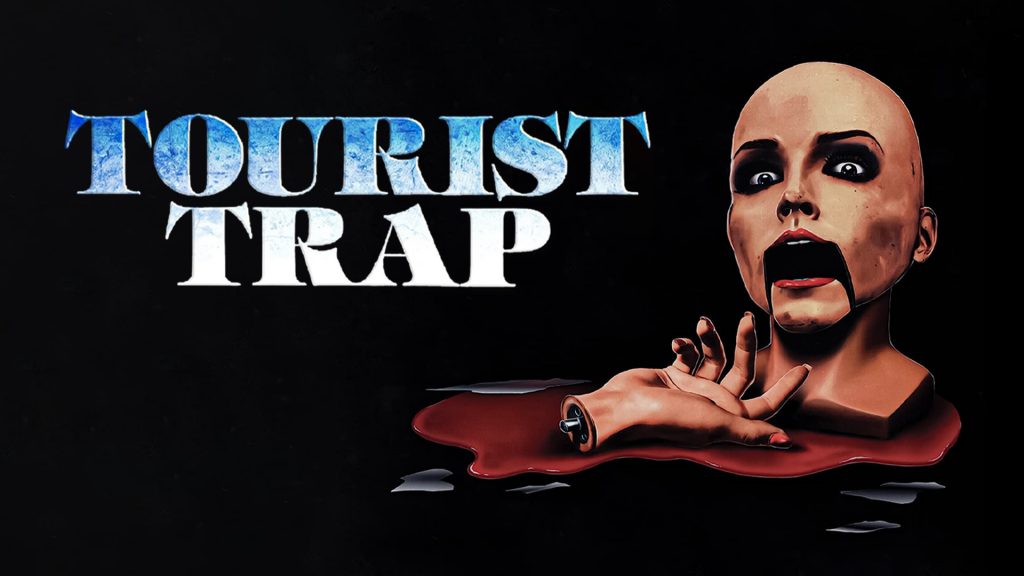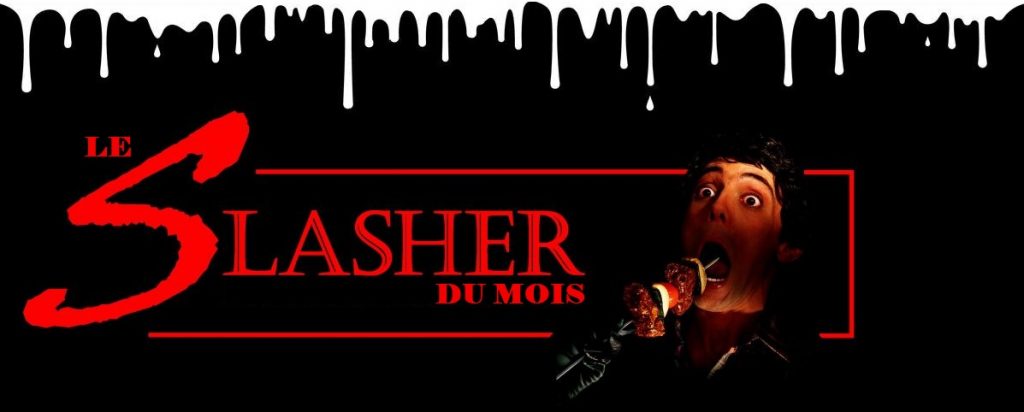Première collaboration du réalisateur David Schmoeller et le producteur Charles Band (qui mènera à Puppet Master, principalement), Tourist Trap (baptisé Le piège à sa sortie en France au printemps 1980) relate l’histoire d’un groupe d’amis égaré dans une contrée perdue, et trouvant refuge dans un petit musée de mannequins de cire tenu par un vétéran quelque peu inquiétant. Si la trame fait d’emblée penser à d’autres métrages, tels que Masques de cire (1933) ou Le moulin des supplices (1960) de par son univers de mannequins artificiels, le film aura d’autres inspirations, de Massacre à la tronçonneuse à Carrie, pour des raisons de prime abord plutôt surprenantes.

C’est dès la scène d’ouverture que l’ambiance s’installe, avec la rencontre incongrue dans une station service abandonnée d’un promeneur égaré et des mannequins lugubres soudain animés comme par magie maléfique. Sous les rires sataniques, le visuel angoissant des mannequins, la musique viscérale de Pino Donaggio (compositeur des partitions de Carrie, Piranhas, Body Double, Hurlements, Pulsions, Trauma et Le fils de Chucky) et la situation tout à fait absurde et effrayante des objets prenant vie, l’ambiance est déjà très glauque, bien qu’en plein jour. Dès lors, lorsque le reste du groupe se retrouve à son tour perdu aux abords de ce chemin ne menant qu’à la ferme du vieux monsieur Slauson revue en musée de fortune, l’issue en sera forcément malheureuse. Il faudra cependant pour cela s’atteler d’une grande patience, doublée d’une indulgence à l’égard des personnages assez sommaires (si ce n’est carrément ennuyeux) n’ayant pas bénéficié d’une personnalité attrayante ni de séquences de dialogues bien passionnantes. Le contraste « jeune génération de la ville » contre « le vieux vétéran rural » ne sera que l’énième exemple du genre, comme on en verra dans toute confrontation entre les protagonistes sensés représenter le public contemporain, et les bouseux un peu débiles du terroir local façon Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse et consorts…

C’est dans un espace naturel un chouilla moins désertique que dans le Texas profond de Massacre à la tronçonneuse, mais habité par autant de piteux énergumènes dérangés que notre petit groupe d’amis va donc s’empêtrer, avant de passer la nuit chez l’habitant venu les mettre en garde contre la dangereuse faune avoisinante, mais après une séquence de baignade dans le plus simple appareil destinée à émoustiller le public masculin. Cette coquinerie ne sera pas totalement assumée et restera la seule note dans l’esprit de tout le métrage (Charles Band se rattrapera plus tard dans la suite de sa carrière). Notre tueur, quant à lui, non content d’arborer un look très proche de Leatherface, avec ici un masque de cire, va frapper un à un les adolescents imprudents, après les avoir introduit dans un monde peuplé de mannequins plus vrais que nature… et pour cause ! Tourist Trap prend donc la liberté de lorgner de près avec le surnaturel, via le pouvoir de télékinésie qu’use le tueur pour arriver à ses fins. Si le spectateur peut froncer les sourcils face à cette décision du scénario (signé Schmoeller et J. Larry Carroll orienté depuis dans le dessin-animé et la télévision) qui ne trouve aucune explication rationnelle, elle a l’avantage d’apporter un élément fantastique qui le diffère de beaucoup des slashers lancés après le succès d’Halloween. Si Tourist Trap n’est pas inoubliable, il sera toutefois un excellent représentant du genre qui inspirera à son tour des films tels que Maniac, La maison de cire, American Gothic ou La sixième victime. Stephen King évoquera même le film dans son livre Danse macabre.

Même si l’identification aux personnages n’est pas chose aisée dans Tourist Trap, le spectateur partage irrémédiablement le malaise que rencontre les protagonistes face à une machination aussi démente (on nage en pleine folie) et paradoxalement foncièrement désuète (quel est le réel but du tueur ?). Les mannequins sont d’abord inquiétants visuellement, déployant des rires et soupirs qui accentuent l’angoisse, puis la panique lorsqu’ils s’animent et s’écroulent tels des dominos sur la final girl en plein traumatisme. Le danger ne se limite pas qu’au tueur, mais à toute son armée de créatures faussement inertes. Grâce à sa musique et à ses effets sonores et visuels, le film dégage dès lors une énergie dans la peur latente qui manquait cruellement à son scénario de base. Il faudra donc affronter l’écart important que représente la première partie du film (excepté, encore une fois, la tétanisante scène d’intro) comparée à son terrifiant deuxième acte (sans omettre un plan final assez dingue, lui aussi).

Au casting, ce Piège comptera sur la présence de la regrettée Tanya Roberts, mondialement connue pour son rôle de justicière dans la série Drôles de dames, ou en James Bond girl dans Dangereusement vôtre (1985). Les charmes de son jolis minois côtoie celui de Jocelyn Jones (L’inspecteur ne renonce jamais) et Robin Sherwood (Un justicier dans la ville 2). À noter que le scénario original prévoyait une belle part de nudité dans le film, notamment lors de la scène du bain sauvage. Le réalisateur David Schmoeller, un peu timide à l’idée de sommer les filles de tomber le haut, s’en remettra à son casting au moment-même du tournage de la scène, récoltant un « non » unanime qui mit fin au débat. L’ironie voudra que Robin Sherwood était déjà nue dans son premier film (Love Butcher) en 1975 et le sera encore dans son dernier (Un justicier dans la ville 2, justement) en 1982, tandis que Tanya Roberts dévoilera finalement ses charmes dans Beastmaster (1982) et sera entièrement nue dans Sheena, reine de la jungle (1984). La gente masculine sera représentée par Jon Van Ness (Rayon X, Alligator II, Hitcher) et surtout Chuck Connors (Soleil vert) cabotinant dans le rôle de monsieur Slauson. Si l’interprétation générale relève tout de même principalement de l’improvisation, force est de reconnaître que le film saura marquer les esprits de part l’enfer infligé aux protagonistes et à leur santé mentale. Pour l’anecdote, le réalisateur a ôté les deux lignes de texte qu’avait la sculpturale scream queen Linnea Quigley (Demon House, Douce nuit sanglante nuit, Graduation Day, Le retour des morts-vivants, Pumpkinhead II, parmi une carrière dans l’horreur incroyablement prolifique) dans le métrage, provoquant la colère de l’actrice qui ne lui a jamais pardonné.

Tourist Trap est finalement traité comme l’adaptation d’un conte dans lequel un homme met en garde les jeunes innocents égarés dans sa demeure du danger que représente son frère fou. La part « télékinésie » du métrage ne fait que souligner cette passe fantastique qui le confère au magique. L’aura mystique était une idée au départ liée à la possession, les mannequins étant originellement hantés par les âmes des victimes, et non les pantins d’un quelconque pouvoir magique du tueur. Le film n’a pas eu le succès escompté lors de sa sortie en salles, malgré la réussite montante du genre après le carton Halloween. Pourtant, et aussi incroyable que cela puisse paraître, le film s’est vu affublé à sa sortie d’une classification PG (contrôle parental conseillé) et non interdit au moins de 13 ans, car cette classification n’existait pas encore à cette époque. Aujourd’hui, il est question de la mise en chantier d’un remake de Tourist Trap, sous la production de l’actrice et scream queen Barbara Crampton (ReAnimator, Castle Freak, You’re next) pour une sortie en 2025. Une décision surprenante pour un film quelque peu oublié, surtout quand on pense que La maison de cire, remake de 2005 du film House of Wax (1953) semble davantage s’inspirer de la trame de Tourist Trap que du film avec Vincent Price dont il est censé être l’adaptation modernisée.