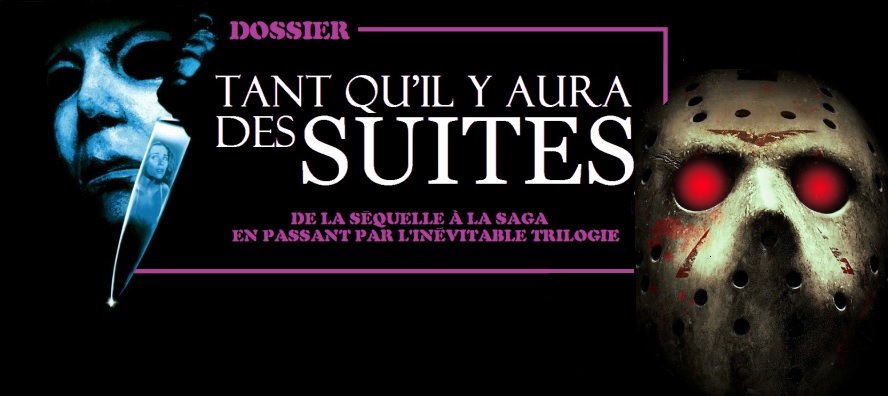Certaines décisions des producteurs ont dirigé des franchises horrifiques vers des recoins inattendus. Stratégies audacieuses, désirs de renouveau ou tentatives de surfer sur la vague parodique, le but était de trouver le moyen le plus judicieux pour perdurer. Sans surprise, la plupart d’entre elles ont conduit leur saga respective à sombrer dans l’oubli, ne respectant pas les codes originaux chers aux fans qui ont contribué au succès des bases de ces franchises. Retour sur les plus emblématiques de ces tactiques risquées du cinéma d’horreur, avec un regard objectif sur ce qu’ils ont tenté d’être à l’époque, et ce qu’il reste d’eux aujourd’hui.
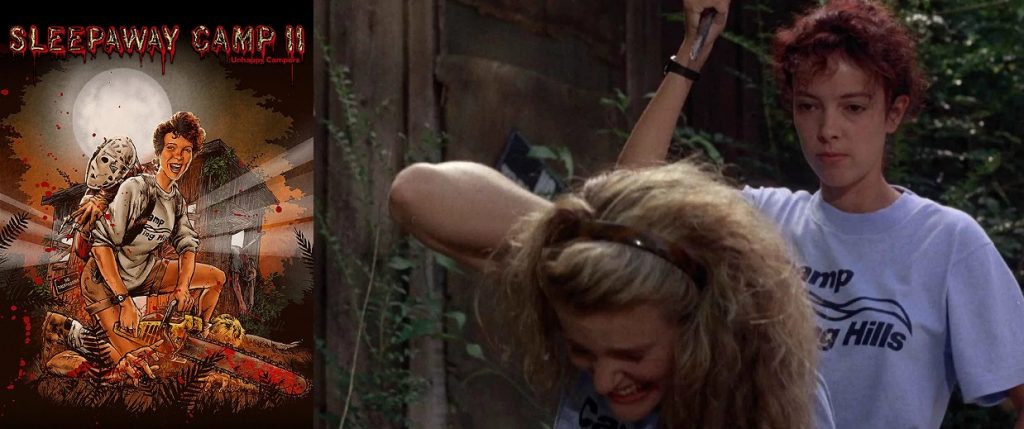
Au risque de manquer de courtoisie aux inconditionnels qui voient un chef d’œuvre derrière chaque film un peu barré en prenant le parti de l’audace et du second degré, reconnaissons que Massacre au camp d’été 2 (1988) est un nanar intersidéral, qu’il soit considéré en tant que suite ou en tant que métrage isolé. Si le film original de 1983 est connu pour sa noirceur et le traitement de son délicat sujet d’épilogue (surtout pour l’époque), avec l’opus 2 on plonge direct dans la bouillasse et à pieds nus. Dépourvu de suspense, de noirceur et en tout lieu de limites, le film de Michael A. Simpson (qui pondra un opus 3 dans la foulée) est un vrai film de vacances, décérébré et fun, qui surjoue à tous les niveaux. Les personnages ne peuvent qu’être des clichés sur pattes, les situations plus aberrantes les unes que les autres, les meurtres sauvages et électriques, nous sommes dans un slasher pur jus, destiné à être un vrai divertissement reposant uniquement sur le woman show exercé par la sœur de Bruce Springsteen (nouvelle héroïne de la saga) et sur la succession de mises à mort plus folles et immorales que jamais. Il pourrait même être une parodie du genre tout entier (on y aperçoit même les pastiches de Freddy, Jason et Leatherface), plus qu’une relecture comique et acerbe du ptemier film. Aujourd’hui, on ne retient toutefois Massacre au camp d’été que pour son film original, oubliant par défaut ces deux suites pour n’avoir jamais considéré l’idée de se prendre un tant soit peu au sérieux, ou les opus 4 (inachevé) et 5 (quasi-inédit) dont la plupart des gens n’ont finalement jamais entendu parler. Et après tout, est-ce vraiment si grave ?

S’il y a une chose qu’on ne peut pas reprocher à John Carpenter, c’est de vouloir faire encore et encore la même chose. Quasiment forcé d’écrire la suite de son film culte par les producteurs désireux de sortir Halloween II (1981) aussi vite que possible, Big John s’en débarrasse dans un immense brasier et vise dans la foulée une alternative aussi puissante d’inattendue avec la production d’Halloween III dès l’année suivante. Le projet de la saga étant alors d’illustrer des histoire indépendantes liées aux festivités d’Halloween, toutes tournées par la même équipe technique et d’acteurs au fur et à mesure, cette histoire de science-fiction sur un sorcier des temps modernes dressant un complot machiavélique pour éradiquer tous les enfants du pays tombe à point nommé. Riche de l’intervention d’un spécialiste de l’univers fantastique noir et piquant en la personne de Nigel Kneale (qui rédige le scénario originel), le film n’est ni une parodie ni un contre-pied caustique mais un complet nouveau chapitre n’ayant ouvertement aucun lien avec les deux premiers films. Cependant, mal vendu par les producteurs et par une presse décontenancée, perdu au milieu de slashers assumés et inévitablement sur-connoté à un Michael Myers indissociable de la mention « Halloween », ce Season of the witch perturbe le public incapable d’en comprendre l’idée. En découle une avalanche de critiques sottes et acerbes qui s’accompagne d’un plantage au box office anéantissant le projet d’anthologie de Carpenter et conduit à l’inévitable retour du croquemitaine au masque blanc dans Halloween 4 en 1988. Aujourd’hui pourtant, le film est culte tant pour les inconditionnels de la saga, que pour ceux qui s’évertuent à y voir une petite pépite isolée qui n’aurait jamais du s’appeler ainsi.

Il aura fallu sept longues années au Bal de l’horreur (le temps pour beaucoup d’oublier le film original) pour accoucher dans la douleur d’une suite qui ne s’attarde même pas à lui faire honneur. Comme l’ont fait d’autres franchises (pas si franches que ça), Le bal de l’horreur 2 (1987) abandonne le slasher lambda pour surfer sur les plates-bandes du fantastique, dont Freddy Krueger a prouvé le potentiel avec déjà trois opus couronnés de succès dans A Nightmare on Elm Street. Débarque alors dans les brancards la sulfureuse Mary-Lou, pauvre victime d’une mauvaise blague de son petit ami et de ses camarades de promo, et dont le cadavérique fantôme vient laisser surgir sa rageuse soif de vengeance. Cherchant à faire de cet ectoplasme plutôt sculptural un nouveau croquemitaine au palmarès des plus emblématiques, le film narre cette abracadabrante histoire surnaturelle à grands renforts de maquillages plutôt convaincants mais de personnages majoritairement insipides. Résultat : un film intéressant mais raté qui ne marquera pas les mémoires. Seul point commun aux différents chapitres de la saga : situer son intrigue au campus Hamilton High, sans retenir ni citer le moindre personnage ou événement ayant eu lieu précédemment. S’éloignant donc complètement du film original, la franchise poursuivra cette parenthèse agonique avec l’opus 3, appelé en France Le bal de l’horreur 3 : dernier baiser avant l’enfer (1990), s’enlisant encore avec le même personnage revanchard, mais par le recours à une autre actrice, dans la parodie la plus avilissante ; avant de revenir vers le film noir avec Le bal de l’horreur 4 : délivrez-nous du mal (1992), qui étale tout de même les méfaits d’un prêtre latino armé d’un poignard-crucifix… À la manière de la saga Douce nuit sanglante nuit, les producteurs de la saga du Bal de l’horreur avaient manifestement abusé de punch durant leur bal de promo.

Comment passe-t-on d’un chef d’œuvre intemporel à une parodie aussi débridée sur la commercialisation du chili con carne ? Avant que Sam Raimi et Joe Dante avec le « retravail » de leur oeuvre phare respective, c’est Tobe Hooper qui s’est chargé d’être le seul décisionnaire de ce que la suite de son film culte allait devenir. Massacre à la tronçonneuse dénonçait en 1974 les ravages de la guerre du Vietnam dans un film dérangeant qui conférait à l’extrême par sa mise en scène, son sujet, ses effusions de gore, et le traitement de son casting (valant certainement à lui seul un film à part entière). Fatalement inquiet de voir son film bafoué par une séquelle qui ne serait au mieux qu’une photocopie sans saveur et au pire un rejeton pas à la hauteur, Tobe Hooper produit et réalise lui-même la suite en 1986. Conscient de ne pas pouvoir réitérer le même impact, et ne souhaitant pas voir Leatherface devenir un croquemitaine de plus dans le paysage du slasher devenu récurrent dans les années 80, il fait de ce Massacre à la tronçonneuse II une parodie déjantée du premier, camouflée en suite par la citation d’un ou deux personnages et en illustrant avec autant d’énergie que possible ce qui anime vraiment la démente famille Sawyer. On nage en pleine folie gore (le film est presque tourné du point de vue des membres fous à lier plutôt que de celui des victimes), quitte l’absurde du premier opus au profit de la franche comédie malsaine se riant des clichés en les grossissant à l’extrême. La tronçonneuse devient l’outil de la souveraineté phallique par excellence (simulation de pénétration face aux cuisses ouvertes de l’héroïne, duel final de gros bras comme s’il s’agissait d’un combat à l’épée), les personnages et la mise en scène hauts en couleurs, le traitement décalé et tous les à-côtés sont renversés les uns après les autres pour marquer un réel décalage avec le premier opus. Si le résultat en a décontenancé plus d’un, cet opus parodique devenu culte à son tour n’évitera finalement pas son monstre principal de devenir le croquemitaine revanchard d’une saga indissociablement liée au slasher movies avec les opus suivants (remake compris). L’exercice était louable (et très drôle, avec le recul), mais ne tirera pas la franchise de sa sanglante destinée.

Célébré, si ce n’est adulé à la sortie de son film en 1984, Sam Raimi présente avec Evil Dead un film de potes qui combine tous les ingrédients propices à la peur : cabane abandonnée dans une forêt sombre, invocation d’un démon malfaisant, maquillages et effets visuels pour une véritable plongée dans l’horreur old school, tout est réuni pour palier à des manques de moyens qui n’ont pas empêché le projet d’être mené à bien. C’est la suite de la carrière de Sam Raimi qui est mise à mal avec l’échec de Mort sur le grill (1985) qui précipite la mise en chantier d’une suite à Evil Dead qui, au départ, devait déjà être cette entrée dans le monde médiéval que sera finalement le 3e opus. La véritable surprise est que Sam Raimi ne possède pas les droits de son propre film, l’obligeant a retourner les scènes qu’il voulait reprendre de son premier film pour ouvrir le second en 1987. Préférant investir son nouveau budget dans les effets spéciaux incroyables pour l’époque (stop motion, jeux de miroir, animatronique, costumes et maquillages pour des morts-vivants plus vrais que nature) que dans la réunion du casting original, le réalisateur se limite au retour de Ash et Lynda dans la cabane maudite. Evil Dead 2 n’est toutefois pas une suite mais une relecture du premier film, plus grande, plus forte, et incontestablement plus folle. Sous couvert de la comédie, appuyée notamment par un look des revenants désormais indissociable de la « patte Raimi » et des gags grand-guignolesques à la limite du cartoon (la main qui crie, l’œil dans la bouche, les flots de sang écarlate voire noir surgissant des murs, le fou rire général du buste de cerf et des objets soudainement animés), Evil Dead 2 réitère les effets choc du film original et les accentue, les améliore, les survolte. En prenant le virage de la comédie pure, gore et généreuse, le film devient immédiatement culte, surpassant même le 3e opus, L’armée des ténèbres (1992), qui décidait de reléguer l’horreur au troisième plan pour s’inscrire corps et âmes d’années dans la comédie. Il prouve ainsi que le juste milieu était l’alliance (dé)mesurée du rire et de la terreur, ce qu’aujourd’hui encore Evil Dead 2 incarne totalement dans le vaste monde de l’horreur.

Ultime exemple de virage mémorable ayant conduit un film culte à explorer son potentiel comique dans une œuvre décalée, voire ici décriée : Gremlins 2, la nouvelle génération (aka The new batch en VO). Réalisé en 1990 par Joe Dante six ans après le cultissime premier opus, qui avait en tout point cassé la baraque au box office par son audacieux mélange de comédie noire et conte fantastique pour enfants pas sages, le second opus est le cas d’école du film dont le réalisateur choisit délibérément de flinguer pour empêcher quiconque de salir l’original (on a échappé ainsi au projet des Gremlins à Las Vegas ou sur Mars, un temps envisagé). Dante rameute donc Gizmo et l’ensemble du casting original pour une nouvelle aventure sous stéroïdes, s’assurant au passage que la sortie de route soit définitive. Joe Dante présentera même son film comme « l’un des films de studios les moins conventionnels de l’histoire » . Il y parvient avec classe, puisque l’apport comique, déjà présent sous une forme dans le film original par l’absurdité et les comportement guignolesque des viles créatures, n’est pas à proprement parler nouveau dans Gremlins 2. Il fait néanmoins disparaître totalement la subtilité au profit d’un sens de l’exagération monumental, dénonçant à grands coups de pastiche tous les travers qu’il voit dans la politique, le marketing, la télévision, et par extension la grandeur américaine au sens le plus primaire qui soit. En ressort un pot pourri aussi indigeste qu’exaltant, parodiant moult films de cinéma, programmes et personnalités du monde de la télévision ou du show business. Le spectateur aurait trop vite fait de crier au scandale en considérant que ce film est l’exemple type de la suite qui en fait trop (c’est d’ailleurs ce qui lui sera reproché à sa sortie) mais ce serait omettre la profondeur du récit et la force des thèmes abordés. En négociant d’avoir totale carte blanche sur le film, Joe Dante s’est amusé (c’est le moins qu’on puisse dire) à intégrer tout ce qui pouvait potentiellement nourrir une saga entière dans un seul métrage, fou, hargneux, et fatal. Un feu d’artifice qui laisse pantois mais qui montre les limites qu’un film ne doit pas dépasser s’il veut survivre à lui-même. Aux antipodes du film original, tout en étant une suite plausible qui ne fait que laisser le champ libre à ses créatures excessives et incontrôlables, Gremlins 2 a fini par devenir une œuvre aussi charnière et culte, par son ton cynique et provocateur (mais comment ne pas succomber au Gremlin intellectuel, au Spider-gremlin ou à Greta, la Gremlin femelle, parmi toute une farandole de créatures cette fois dotées d’une véritable personnalité voire identité ?). Le film original et sa suite ont d’ailleurs de nombreux adeptes, mais les fans de l’un sont rarement les mêmes que ceux de l’autre. Allez savoir pourquoi…

On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête des possesseurs de la franchise Douce nuit sanglante nuit pour avoir enchaîné avec une dextérité sans faille des opus aussi insignifiants et contre-productifs les uns envers les autres. Dès 1987, le second opus reprend sous forme de best-of les séquences clé du film original de 1984 pour combler les brèches d’un scénario miséreux et le manque de scènes sanglantes de cette absurde redite éveillant encore aujourd’hui davantage le rire moqueur que l’adoration. Passons l’opus 3 qui tire l’abject sur 90 minutes supplémentaires en recourant à un croquemitaine moisi traité avec autant d’irrespect que la créature de Frankenstein. Arrive alors cet intriguant Douce nuit sanglante nuit 4 : l’initiation, réalisé en 1990 par Brian Yuzna (Re-Animator 2, Le dentiste), et qui, comme on ne pouvait absolument pas s’y attendre, oublie son histoire de Père Noël tueur pour traiter de celle d’une reporter enquêtant sur la mort suspecte d’une femme atteinte de combustion spontanée et liée à une communauté de sorcières féministes cherchant à annihiler la gente masculine de la surface de la Terre. On croit rêver, mais c’est bien là le pitch du film, qui au moins se déroule à la période de Noël (c’est toujours ça). Cet opus 4 serait sans conteste la définition la plus proche du mot « bizarre » (mais n’ayons pas peur des mots : on nage en plein délire), dont on cherche toutefois encore en quoi il a un jour été considéré comme LA bonne idée pour remettre la saga sur les rails. À moins, encore une fois, que les producteurs ne réalisait pas l’étendue du désastre. N’en déplaise, un cinquième chapitre traitant d’une invasion de jouets maléfiques débarquera un an plus tard, pour le meilleur et pour le rire.

Ultime preuve que les années 2000 sont un melting-pot de toutes les horreurs possibles et imaginables : Urban Legend 3 (2005), qui abandonne le format du slasher au profit du surnaturel via une pathétique histoire de fantôme revanchard comme on en a vu des milliers (et toutes bien meilleures, comme le fameux Bal de l’horreur 2 auquel Urban Legend 3 ressemble d’ailleurs beaucoup). Citée dans le premier opus dans le cadre d’une blague d’étudiants, Bloody Mary tire son origine du folklore anglo-saxon parfait pour une légende urbaine. Après tout, ce mythe n’a-t-il pas à sa manière inspiré Candyman (1992) ou été dépeint dans des productions aussi variées que Paranormal Activity 3 (2011) ou Mary, Mary, bloody Mary (1975) ? La véritable tâche dans le tableau, c’est le traitement général du film, un sous-produit destiné au marché de la vidéo, n’entretenant aucun lien avec les précédents opus, et laissant y cabotiner des acteurs de troisième dose sur fond de très mauvais effets spéciaux. Le tout avec comme toile de fond l’idée d’un fantôme qui décide de tuer en invoquant des sorts liés aux légendes urbaines les enfants de ses bourreaux car ceux-ci ne sont pas assez respectueux envers le sort qu’elle a subi trente-cinq ans auparavant. Devant pareille mièvrerie, les véritables surprises seront d’y trouver au casting une Kate Mara encore débutante (et déjà mauvaise) ou Don Shanks (Myers dans Halloween 5) dans le rôle du coach, et surtout Mary Lambert à la mise en scène de cette purge astronomique. La réalisatrice de Simetierre 1 & 2 semble s’être enlisée dans ce projet insipide avec autant de terreur et de tristesse que les personnages du film face à ce fantôme moisi en atroces images de synthèses. Mais quand on sait que Mary poursuivra sa mise en abîmes avec Mega Python versus Gatoroid quelques années plus tard, on s’étonnera beaucoup moins. Reste que le Urban Legend original, réalisé en 1998 par Jamie Blanks, s’il n’avait l’ambition de devenir une franchise, méritait bien mieux que les sous-fifres qui l’ont suivi, manquant d’accorder à ce slasher le statut légitime et louable dont il était incontestablement digne. Urban Legend 3 sera quant à lui l’un des virages à 180° les plus (malheureusement) regrettables et (heureusement) oubliables du vaste monde de l’horreur.