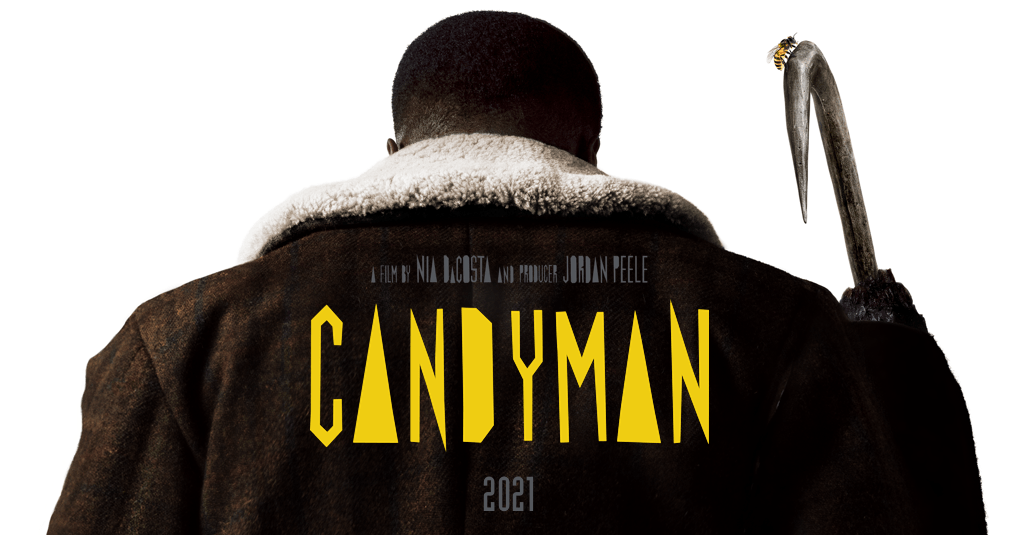PARTIE 1 : LE PHÉNOMÈNE DE LA REDITE
Qu’il s’agisse de se rapproprier un film (et son potentiel succès) ou de configurer une œuvre dans un contexte plus actuel, le remake est devenu une mode en pleine expansion depuis le début des années 2000. Déjà près d’un quart de siècle de renouvellement infini, sans que le phénomène ne tarisse, et ce malgré un engouement accompagné fatalement par son lot d’immenses déceptions. Comment expliquer pareil recours à la redite, dans le cinéma en général et, accessoirement, dans le monde horrifique ?

PREMIERS MÉFAITS :
La notion de remakes ne date pas d’hier, car très tôt l’idée de s’emparer d’une oeuvre déjà existante plutôt que de créer une nouvelle histoire a semé le trouble dans l’univers cinématographique. En effet, dès 1904, The great train robbery de Siegmund Lubin devient le premier remake de l’Histoire, copiant une œuvre homonyme signée Edwin Stanton Porter et sortie un an plus tôt. À la recherche d’une prouesse visuelle, le véritable combat de l’époque, au détriment de la morale, cette première usurpation aura vite fait de lancer l’étalage de protections des œuvres culturelles au cinéma. Mais des histoires surprenantes des origines du remake, notons Le mari de l’indienne, réalisé par Cécil B DeMille en 1914, premier long-métrage hollywoodien de l’Histoire, que le réalisateur refait en 1918 avec un véritable souci d’amélioration artistique, avant d’en signer une troisième version en 1931, avec une version parlante. A l’époque il n’apparaît donc pas encore incongru de refaire un film, dans l’intention de le perfectionner. Comme Van Gogh signa plusieurs versions de ses tournesols en son temps, DeMille réalisera par ailleurs Les 10 commandements en 1923 (en noir et blanc et en muet), avant de reproduire l’exploit en mettant en chantier le chef d’oeuvre homonyme de 1956, son dernier film, avec Charlton Heston.
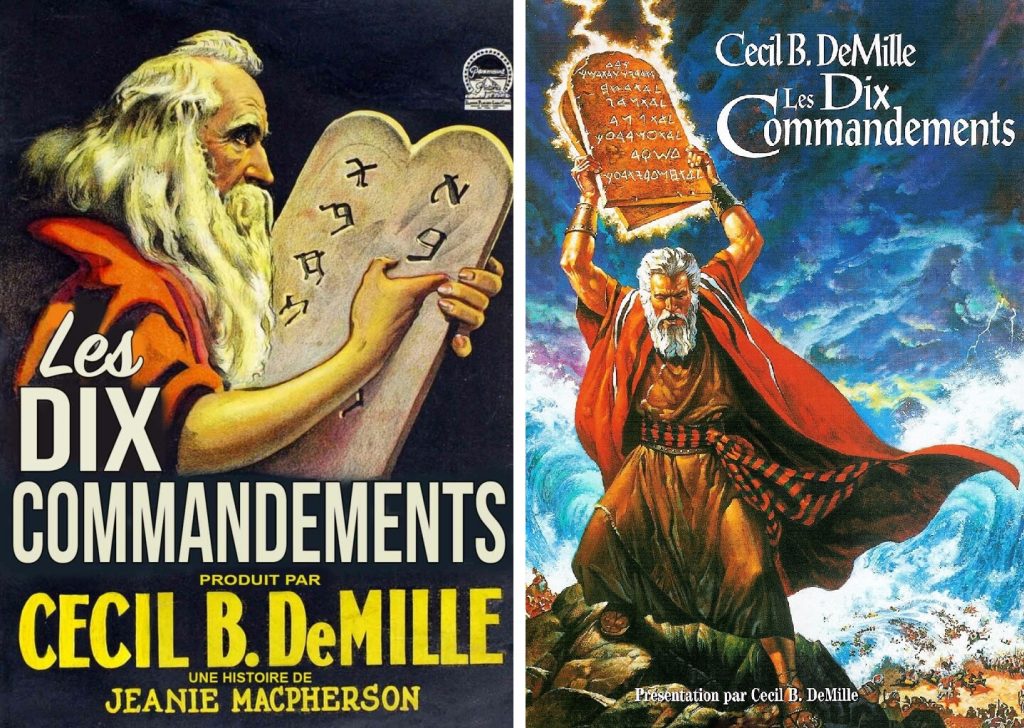
Le grand Alfred Hitchcock se frotta également à cet exercice, profitant des améliorations des techniques de réalisation, en tournant deux fois L’homme qui en savait trop. La première version, en 1934 avec Peter Lorre (M le maudit) est un succès critique marquant les débuts du cinéaste, tandis que la version de 1956, avec James Stewart, sera doublée d’un succès commercial colossal, juxtaposant toutes les prouesses et effets de style propres au légendaire metteur en scène du film à suspense. Certains récits ont le potentiel de se déployer indéfiniment pour traduire un regard nouveau sur l’époque, avec des moyens modestes ou considérables, comme en témoignent les nombreuses adaptations de moments historiques phares comme le naufrage du Titanic (Titanic / S.O.S. Titanic / Atlantique, latitude 41 / A night to remember…) ou de personnalités historiques ancestrales (Cléopâtre, Napoléon, Christophe Colomb…) ou littéraires et religieuses (Le comte de Monte-Cristo, Sherlock Holmes, Jésus-Christ…).

LE CAP DES 29 ANS ?
Mais la véritable mode des remakes, celle ouvertement entamée dans les années 2000, et lorgnant au registre du film horrifique, s’ouvre avec Massacre à la tronçonneuse, que réalise Marcus Nispel en 2003. Boostant une franchise très inégale disparue des radars au milieu des années 90, le film est un succès retentissant, donnant fatalement des idées aux maisons de production voisines. Après Leatherface chez Platinium Dunes, c’est Michael Myers puis Jason Voorhees qui viendront casser la barque au box-office. Ces trois projets ont lancé l’idée folle que les franchises renaissent de leur film d’origine après 29 ans (Texas Chainsaw 1974/2003, Halloween 1978/2007 et Friday the 13th 1980/2009). En sont preuve également La Mouche 1958/1986, The Crow 1994/2024, Simetierre 1989/2019 The Thing 1951/1982/2011, La Colline a des yeux 1977/2006, Black Christmas 1976/2006, Firestarter 1984/2022, Le Blob 1958/1988 et Candyman 1992/2021 qui ont tous refait peau neuve après quasiment pile 30 ans.

REMAKE/REBOOT/REQUEL ET CONSORTS, SUBTILITÉ DE LANGAGE :
S’en sont suivi quasiment toutes les grandes sagas horrifiques, des plus emblématiques (Les griffes de la nuit, Chucky : jeu d’enfant, Hellraiser) au plus oubliées (Le beau-père, Weekend de terreur, Black Christmas) pour des résultats passant du chef d’oeuvre (Evil Dead 2013 ou Candyman 2021) au désastre le plus cuisant (Carrie, la vengeance ou Black Christmas 2019). Cette mode des remakes a ensuite évolué en notions alternatives telles que le reboot (qui, à la différence du remake, ne recopie pas le film d’origine mais uniquement un personnage ou un univers du film originel pour l’exploiter différemment, comme Hellraiser 2022 ou Alien : Romulus), le requel (mélange du remake et de la suite, comme Scream 2022 ou Souviens-toi l’été dernier 2025), le spin-off (un personnage ou un univers extrait d’un film pour devenir une autre franchise, façon Annabelle ou La Nonne, issus de Conjuring) ou la legacyquel (mélange de legacy et sequel qui efface toutes les séquelles de trop pour faire suite directe au film original, comme Halloween 2018 ou L’Exorciste : dévotion). Notons également le phénomène du live action qui vise à tourner quasiment à l’identique un métrage d’animation en prises de vues réelles (du Roi Lion de 2019 à Lilo et Stitch ou Dragons en 2025). Fer de lance des studios Disney depuis le succès d’Alice au pays des merveilles en 2010 : en gros, on fait un remake… mais autrement.

DEUX POIDS, DEUX MESURES :
Un remake vaut-il mieux qu’une nouvelle suite ? Assurément oui, quand on voit les résultats de The amazing Spider-man ou même Spider-man homecoming, survolant (c’est peut de le dire) l’histoire de l’homme-araignée toutes les demi-douzaines d’années. L’univers des super-héros est à la fois un excellent et très mauvais exemple de remakes, la surenchère d’œuvres se tirant chacune la couette au détriment de son public (Les 4 fantastiques en 1994, puis en version moderne et candide en 2005, puis en version jeune et livide en 2015, puis en version cool et vintage avec First steps en 2025), mais dans le respect des innombrables versions des comics reprenant encore et encore les mêmes histoires pour les décliner à l’infini. On ne compte plus les nombreux visages de Batman ou de Superman ces quarante dernières années, comme si les super-héros ne vivent indépendamment qu’à travers leur interprète du moment (façon James Bond, finalement). Côté horreur, notons l’innombrable série de remakes de Massacre à la tronçonneuse (2003, 2013, 2022, 2026), cherchant à relancer inexorablement une saga qui n’a jamais su s’étioler correctement sur plusieurs suites (les 2e et 3e opus étant eux-mêmes en leur temps déjà des remakes plus que de simples séquelles).

LE REMAKE AMÉRICAIN, DIEU DOLLAR TOUT-PUISSANT :
Si le géant américain est souvent de la partie en guise de remake, c’est malheureusement parce que la définition-même du cinéma actuel est indissociable de l’Oncle Sam (à tort ou à raison leader du marché audiovisuel, pour des raisons principalement financières). Non content de reproduire à outrance ses mêmes films sous le même schéma, il s’approprie aussi les succès nationaux de par le monde. À juste titre, puisqu’il ne s’agit pas d’un vol mais bel et bien d’un compromis. Pour un producteur de film, céder les droits de remake est souvent plus intéressant financièrement que d’attendre les recettes éventuelles d’une sortie à l’étranger, et principalement aux USA. Morse (Suède) se transforme en Let me in, Ringu (Japon) s’étiole en The Ring – Le Cercle, À l’intérieur (France) accouche d’un Inside, et [REC] (Espagne) devient En Quarantaine. Passent à la moulinette US des métrages aussi variés que Funny Games, The Grudge, Millenium, Les Infiltrés ou Speak no evil. À l’échelle de la France, c’est pourquoi Le Dîner de cons ou Intouchables sont devenus The Dinner et Sous un autre jour (The Upside) aux États-Unis. Exception faite de certains films purement sous l’enveloppe nationale restés intacts (Le fabuleux destin d’Amélie Poulain) tandis que d’autres ont parfois été totalement remaniés et perdant ainsi toute leur essence originelle (Taxi revu à la sauce américaine ou Bienvenue chez les ch’tis remaké en Italie sous Benvenuti Al Sud). Tout n’est pas à écarter puisque le remake le plus célèbre reste celui de La Totale ! devenu l’énormissime True Lies de James Cameron. Des productions françaises s’étant enlisées dans le sable mouvant putride du remake américain, on peut citer Un indien dans la ville devenu Un indien à New York (avec Tim Allen), Trois hommes et un couffin devenu Trois hommes et un bébé (avec Tom Selleck) et pêle-mêle Nikita, Banlieue 13, Neuf mois ou encore Mon père, ce héros et LOL. De sinistre mémoire, ajoutons aussi l’infâme Les Visiteurs en Amérique, tourné par le même casting français (acteurs et réalisateur) mais en remaniant noms des personnages et intrigues additionnelles, abandonnant au passage le respect du public français et toute trace de pouvoir comique. Pour anecdote, c’est le film Perfetti sconosciuti, une comédie italienne de 2016, qui met en scène un dîner qui dégénère quand les convives commencent à regarder dans le téléphone de leur voisin, qui détient ainsi le record au Guiness Book du nombre de remakes, avec 19 versions réalisées en trois ans. Il a notamment été adapté en France (aka Le jeu en 2018), au Mexique, en Corée du Sud, en Russie, en Allemagne et en Pologne. (source : radiofrance)

WOKISME ET MÉTAPHORES :
Les années 80 et 90, voire 2000 ont tenté de remanier certains films en jouant sur le côté solennel et culte des œuvres originales. La mouche noire, réalisé en 1958 avec à son bord Vincent Price, est devenu le classique de science-fiction La Mouche en 1986 sous l’œil de David Cronenberg. La critique a réussi à voir derrière la dégénérescence du corps humain une allégorie du virus du Sida comme signe d’aliénation menant à la destriction pure et simple de l’être humain (The Thing de John Carpenter en était aussi un exemple et une victime). Le vrai virus n’est-il pas plutôt celui du wokisme qui, dans les années 2010 et 2020, s’est emparé du monde pour accoucher dans la douleur de versions estampillées d’un féminisme outrancier et exacerbé avec S.O.S fantômes 2016, Ocean’s 8, Black Christmas 2019, ou encore Charlie’s angels ? La question se pose encore aujourd’hui, tant le bien pensant voulant une place pour chaque catégorie ethnique, sexuelle et religieuse a au contraire mené à une confusion telle que plus personne ne se reconnait en rien sans s’insurger au préalable que les codes d’honneur puissent ne pas être respectés. On se retrouve ainsi avec une adaptation de Blanche-Neige (2025) ôtant les sept nains de son titre, pour ne pas heurter les personnes de petite taille, devenues dans le film des êtres en images de synthèse dotés de pouvoirs magiques. Quand le rêve laisse place à la supercherie…

Objectivement, un remake n’a pas forcément vocation à « faire mieux » que son modèle, 91% des spectateurs préférant toujours le film original à son remake. En horreur/fantastique (comme dans tous les genres), les plus mauvais élèves sont généralement ceux qui sont allés paresseusement plagier le film original sans apporter la moindre consistance à la copie (Psycho en 1998, Le Beau-Père en 2009, Freddy : les griffes de la nuit en 2010 ou Poltergeist en 2015), tandis que les meilleures auront renforcé le produit de base pour y incorporer une énergie ou une âme solide et contemporaine (Amityville 2005, Halloween 2007, Evil Dead 2013 ou Candyman 2021). D’autres encore ont exploité le titre ou univers d’origine en passant complètement à côté de l’œuvre, ne donnant alors naissance qu’à une abomination tout juste bonne à jeter aux orties (April Fool’s day 2008, Le Bal de l’horreur 2008 ou Fright Night 2011). Alors, qu’il s’agisse d’un projet de bonne ou mauvaise volonté, la mode des remakes est-elle le signe qu’Hollywood n’a plus le pouvoir de nouvelles idées pour ainsi piocher dans les malles de son grenier, ou y a-t-il un réel intérêt artistique et culturel à photocopier des œuvres pour garantir une continuité voire légitime longévité ?