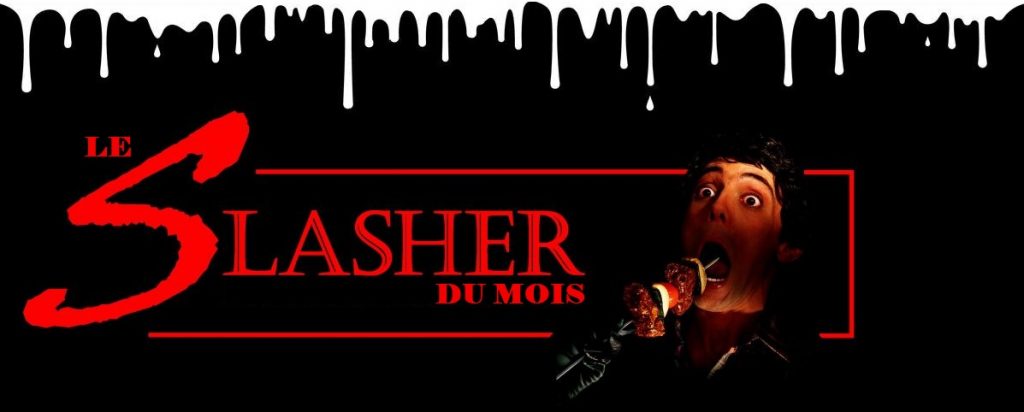En 1987, le slasher fête bientôt ses dix ans. Personne ne sera là pour souffler les bougies, puisque les producteurs du genre sont encore occupés à essayer de tirer la plus grosse part du gâteau. Pour tenter de percer, les films continuent de s’enchaîner avec des tueurs déguisés en astronautes, en momie ou en bonhomme de neige, et des mobiles allant de la vengeance de l’orphelin au penchant sadique pour le meurtre au tournevis cruciforme. C’est l’époque de disgrâce du tout et n’importe quoi qui croit impunément pouvoir encore renouveler le succès d’Halloween ou de Vendredi 13. À l’heure ou cette fièvre du genre commence à congeler, John Hough, metteur en scène de La maison des damnés, Incubus et Les yeux de la forêt (et futur réalisateur de Hurlements 4), décide avec ce American Gothic de prendre le slasher movie à contre-courant. Cette fois, pas de tueur masqué, pas de mobile foireux, et dans la foulée, pas de date de calendrier maudite. Ou pas tout à fait, car American Gothic va en fait plonger sa bande de jeunes innocents dans une autre époque, et (heureusement) sans machine à remonter le temps.

Pour cela, le scénario conduira une troupe d’amis sur une île reculée, habitée par une famille qui s’est enfermée dans le mode de vie des années 20. Ma, Pa, comme sont surnommés les parents (interprétés avec brio par Yvonne De Carlo vue dans Le silence qui tue et Les dix commandements, et Rod Steiger vu dans Docteur Jivago et Amityville), élèvent à la dure leurs trois enfants loin de toute trace de modernité. Pas d’électricité, pas de confort, la famille donne la part belle au travail, à une éducation sévère et à des valeurs inscrites quelque part dans la Bible. Forcément, l’arrivée inopinée de six jeunes adultes bien ancrés dans leur époque va semer le trouble dans le quotidien archaïque de cette famille hors du commun. Car le contexte historique dans lequel s’est enlisée la famille de Ma et Pa ne sera pas le seul hic au tableau. Les trois enfants du vieux couple ne feront que compliquer les choses, à commencer par Fanny, première à se montrer à l’écran, et dans la foulée aux malheureux égarés.Affublée d’une robe d’enfant et clamant avec énergie sa joie de fêter bientôt ses 12 ans avec toute sa famille, Fanny a pourtant physiquement l’allure d’une dame d’une cinquantaine d’années bien trempées. Et lorsque ses frères Woody et Teddy feront à leur tout leur apparition, ils ne feront que confirmer le malaise. Les vieux enfants de Ma et Pa ont un âge avancé mais les attitudes de jeunes enfants, voire de garnements physiquement et mentalement très inquiétants.

Loin de vouloir étaler une morale religieuse qui de toute manière aurait été déplacée et contraire au genre, American Gothic se contentera d’enchaîner les meurtres sans jamais aller vraiment au bout de la peur qui aurait pu véhiculer. La première mise à mort sera pourtant prometteuse, bien que simple. Une balançoire, et deux effrayants adultes/enfants qui s’en prennent à un innocent. La réalisation maintient le suspense, tandis que le visage et les attitudes angoissants des tueurs soulèvent l’inquiétude. A-t-on affaire à des tueurs enfants enfermés dans des corps d’adultes, ou à des adultes déments habillés en bambins ? Une question d’autant plus gênante que cette folie est un secret caché et entretenu par des parents austères et intransigeants. Éduqués dans de pareilles conditions, les enfants-monstres n’en sont pas moins irresponsables. Pour renforcer cette notion, une scène montrera Fanny cachée derrière un arbre et écoutant malgré elle les méchants propos que portera une fille sur elle, ses vêtements ridicules et son physique ingrat. La réaction de tristesse et de détresse de Fanny face à ces moqueries prouveront qu’elle est bel et bien une enfant, ou que tout du moins elle n’est pas capable de réagir en adulte.

Les autres meurtres du film seront à la fois le déroulement logique d’un slasher, mais aussi la perte d’un synopsis dont le potentiel aurait pu être bien mieux exploré. Aiguilles à tricoter, corde à sauter, faucille et figurine de chevalier en fonte, tout deviendra une arme mortelle lors de mises à mort malheureusement hors champ. La peur générée par American Gothic ne reposera pas sur ses meurtres, mais sur ses personnages et son ambiance. En fait, le film réconcilierait n’importe quel adepte du « c’était mieux avant » avec l’époque actuelle. Car cette version trash et déjantée de La petite maison dans la prairie va, dans son dernier quart d’heure, jouer sur une énième pirouette pour se démarquer de ses congénères. American Gothic, c’est l’alliance du slasher, avec ses armes insolites, et du survival, avec le volte-face de la final girl Cynthia, enlisée en pleine aliénation mentale. En effet, cette jeune mère traumatisée par la mort de son enfant, et ses amis, vont subir les assauts de cette famille démente, avant de choisir d’affronter ses bourreaux, comme dans un élan de désespoir et de folie furieuse. L’idée n’était pas mauvaise, mais elle sombre dans la facilité en fin de métrage (la faute sans doute aux remaniements de dernière minute effectués par le réalisateur). Et surtout, elle ne sait pas à quoi mener puisque le générique de fin déboulera comme un cheveu sur la soupe, donnant à l’ensemble une amère sensation d’inachevé. Dommage, car le film, somme toute très agréable à regarder (à condition d’oublier illico la VF !) avait une trame assez originale et surtout un casting convaincant pour faire d’American Gothic un film hors du temps et surtout des sentiers battus.


Bien que le titre du film joue sur l’assonance de l’œuvre artistique de Grant Wood (notamment avec les affiches très efficaces destinées à vendre le film), le métrage de John Hough a été réalisé au Canada, sur l’île de Bowen Island, près de Vancouver. Le tournage a eu lieu durant l’hiver 1986/1987, impliquant des conditions météorologiques assez difficiles pour le casting. L’actrice Sarah Torgov (l’héroïne Cynthia) a décrit le tournage comme physiquement éprouvant, et se souvient qu’elle dormait en moyenne quatre heures par nuit : « La plupart des nuits, nous travaillions si tard que nous devions nous précipiter frénétiquement, toujours en costume, pour attraper le dernier ferry. Si nous portions par exemple un pyjama lors du dernier plan tourné de la journée, c’est en pyjama que nous rentrions à la maison » .

À l’origine, c’est Stephen Shellen (Et au milieu coule une rivière, Bodyguard, Le beau-père), qui joue Paul dans le film final, qui devait avoir le rôle principal. Ce n’est qu’une semaine avant le début du tournage, alors que Shellen s’est retrouvé mêlé à une bagarre dans un bar, que ce changement a été effectué, à la décision du réalisateur. L’acteur s’était présenté avec le visage tellement abîmé que John Hough a décidé de limiter son temps à l’écran (on le voit souvent dans l’obscurité ou de dos, même dans la barque quand son personnage finit par être tué). Ce dernier a retravaillé en urgence le scénario de façon à faire de Cynthia le personnage principal, agrémenté de ses pathologies. John Hough apparaît même en temps que co-scénariste dans la version britannique du film. American Gothic a aussi eu comme titre de travail Kids, avant d’être distribué sous le titre Hide and Shriek sous la format VHS anglaise, ou Une affaire de famille lors de son exploitation dans les salles françaises. Lors de sa sortie, le film a été très tièdement reçu par le public, non aidé par les critiques sévères qui ont descendu le film en flèche, considérant d’ailleurs que les rôles de Ma et Pa, soit Yvonne De Carlo et Rod Steiger, étaient, selon le New York Daily News, les plus humiliants de toutes leurs grandes carrières respectives.