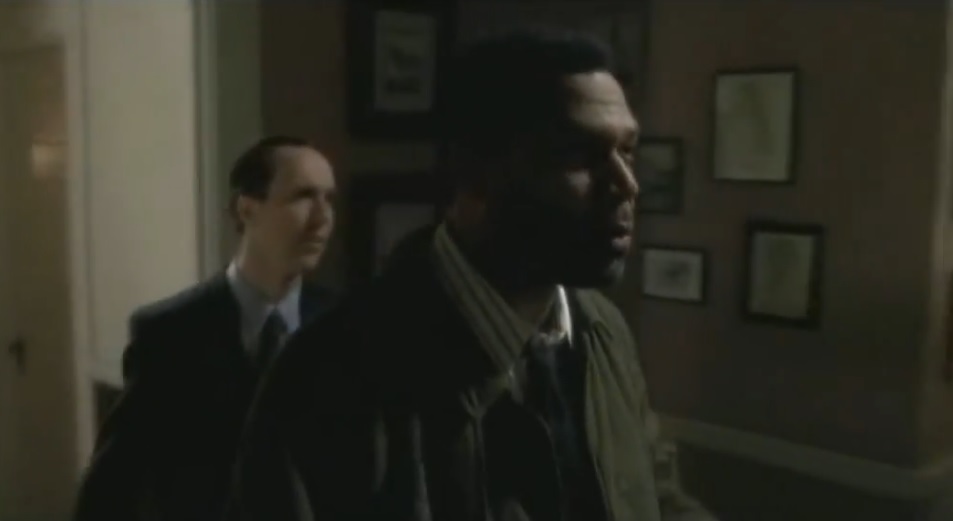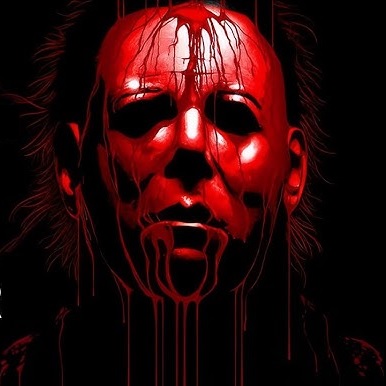Après le résultat en demie teinte d’Halloween 6 : the curse of Michael Myers lors de son exploitation en salles américaines en 1995 (à peine plus de 15 millions de dollars), la firme Dimension décide de changer de stratégie. Venant de racheter les droits de la franchise pour surfer sur la notoriété du personnage de Michael Myers, les producteurs voient d’un tout autre oeil l’avenir de la saga. Bien avant que Jamie Lee Curtis vienne elle-même remettre le pied à l’étrier et aider au projet anniversaire d’Halloween H20, et après l’éviction de l’idée d’un Halloween 7 : the son of Michael Myers préparé par Daniel Farrands (Halloween 6), une alternative est envisagée. Ce scénario, baptisé Halloween 7 : two faces of evil, a été écrit de la main de Robert Zappia, futur scénariste de la version définitive d’Halloween 20 ans après. Le jeune scénariste, fan de l’opus original, avait saisi l’opportunité de rédiger une ébauche pouvant servir à la suite de la franchise. L’idée n’était plus de faire suite aux trois précédents métrages, mais de conduire la saga dans une nouvelle direction. Dans un sens, la logique confortait cette décision, puisque la plupart des personnages et piliers originels (Laurie Strode, Jamie Lloyd et le Dr Loomis) étaient décédés. L’histoire traitait alors de Michael Myers, s’échappant d’une prison de Middle Rock dans laquelle il était enfermé depuis trois ans, qui se mettait en chasse de Joanne, 17 ans, dans un établissement étudiant réservé aux filles. La production, refroidie et déçue des résultats d’Halloween 6, aurait débloqué un maigre budget à cet opus destiné un temps au marché de la vidéo. Une décision dans la mouvance de ce que Dimension prévoyait (ou avait déjà acté) pour les autres franchises qu’elle avait racheté (Hellraiser, Children of the corn), et qui était un crève-cœur pour le producteur exécutif Moustapha Akkad. Car passer du cinéma au direct-to-video et descendre ainsi d’un cran implique indubitablement une baisse dans le budget, la qualité, et le regard critique. Sans oublier qu’il est difficile voire impossible pour une franchise passée en mode vidéo de faire ensuite machine arrière et retrouver le chemin du grand écran. Le premier jet de Halloween 7 : two face of evil a été rendu le 11 juillet 1997, après six semaines d’écriture. La production était prête à être lancée quelques semaines plus tard, pour une sortie au courant de l’année 1998. Robert Zappia fut invité par Bob Weinstein pour discuter de son scénario, fait plutôt rare de la part du producteur de Dimension. Lors de cet entretien, Weinstein annonça à Zappia une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne étant que son scénario était très bon. La mauvaise, qu’il n’allait pas être adapté pour le film.

D’après le scénario, le film s’ouvrait le soir du 29 octobre 1998, à Nauvoo, en Illinois. Debra, une jeune adolescente obligée de surveiller son petit frère Lee, 10 ans, et ses camarades occupés à une partie de cache-cache dans leur grande maison, est mortellement attaquée dans sa chambre par un tueur au masque. Lorsque la police arrive, alertée quelques minutes plus tard et dirigée par l’inspecteur Kinkade, celui-ci ne peut s’empêcher de relever les similitudes avec les souvenirs passés :
– Baby-sitter, arme mortelle, blessures au couteau, à quelques jours d’Halloween… même mode opératoire que Michael Myers.
– Les meurtres d’Haddonfield ? demande son adjointe Janet Blake.
– Il semblerait qu’il se soit rendu sur un terrain plus fertile…
Surprise d’entendre son chef considérer la possibilité que Myers soit à l’origine de ce meurtre, Blake rappelle alors que le tueur est prisonnier à Middle Rock, depuis sa capture aux abords de Smith’s Grove par le S.W.A.T après les événements du 31 octobre 1995.
– Vous pensez qu’il s’est évadé ? demande Blake.
– Ça ne serait pas la première fois.
– Aucun homme ne peut s’échapper de Middle Rock.
– On ne parle pas d’un homme, enchérit Kinkade.
Blake ne peut alors s’empêcher d’ajouter :
– Cela sonne comme les propos de ce vieux docteur… quel était son nom ?

Cette scène d’ouverture pose les nouvelles bases de l’intrigue, tout en respectant le final du film précédent, et ouvrant le champ à de nouveaux personnages, et d’intrigues lorgnant de près le film original. Certains lieux, noms, situations ou références ont été conservés pour le film final (l’académie de Hillcrest, le nom de Wittington, d’abord donné à l’héroïne Joanne, le mur plein de coupures de presse liées à Myers et à son parcours sanglant, Joanne voyant Myers par la fenêtre pendant un cours…). Comme souvent dans la saga, certaines idées de ce scénario ont été conservées pour de futurs films (le corps de Myers transféré à la morgue pour autopsie, repris dans Halloween Resurrection), ou au contraire reprennent des éléments décrits dans de précédents scripts non conservés à l’image (la chanson Mister Sandman des Chordettes qui résonne à la radio, comme dans le script original d’Halloween 4 lors du transfert de Ridgemont). On trouve même dans cette ébauche une réplique qui trouvera son sens dans Halloween Ends : « Evil never dies. It just finds a new host » (traduisible en « Le Mal ne meurt jamais. Il se trouve seulement un autre hôte« ) . Au niveau des dialogues, on retrouve les marques propres au travail de Robert Zappia, toujours présentes dans l’Halloween H20 finalement tourné. Par exemple, lorsque Kinkade demande à Blake si le petit frère de la première victime a un alibi, l’adjointe s’étonne de la question, l’enfant n’ayant que 10 ans.
– Le petit Myers n’avait que 6 ans lorsqu’il a commencé, rétorque Kinkade en crachant la fumée de sa cigarette au visage de son adjointe.
Janet lui envoie alors :
– Personne ne vous a jamais dit que le tabagisme passif, ça tue ?
– Si, mais ils sont morts.

Le titre trouve son explication dans l’autre dominante du film, qui suit l’inspecteur Kinkade, en contact avec Cain Gabriel, un fou dangereux provocateur, prestidigitateur à ses heures, adepte de Michael Myers, et qui lui offre son aide dans la traque du véritable tueur au masque (un hommage vague au Silence des agneaux). Myers n’était dès lors plus le seul tueur dans le film (une idée soufflée par le producteur Paul Freeman, adaptée ici par Zappia pour l’ébauche de ce scénario). L’essentiel du film relatait de cette enquête policière menée par un Kinkade aux méthodes peu orthodoxes et son acolyte magicien psychopathe, additionnellement à la vie de lycéenne de Joanne et de ses amies Sharon et Linda, dont le modèle est calqué sur la triangulaire des trois héroïnes dépeintes par Debra Hill dans le film original (notamment avec le principe de la virginité de l’héroïne très moquée par ses camarades).
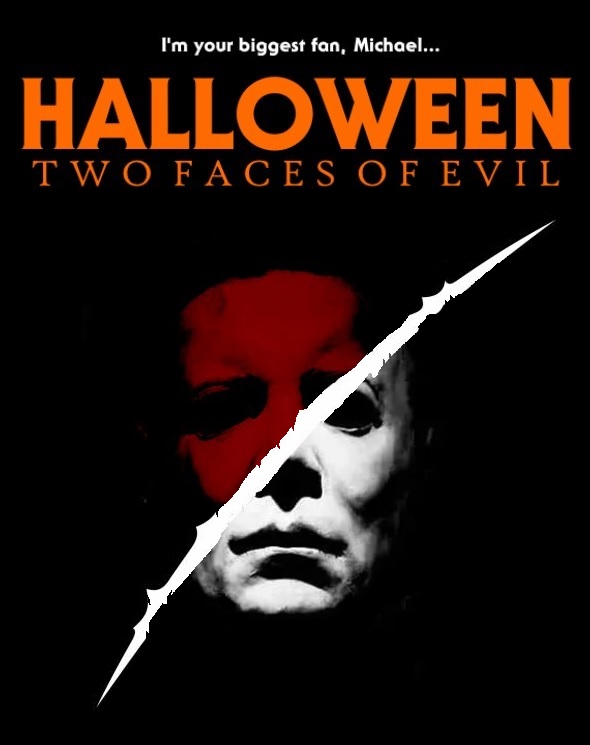
Le final devait se dérouler sur le campus. Myers poursuivait Joanne jusque dans un clocher, tandis qu’une grande fête d’Halloween occupait le reste des protagonistes étudiants dans un gymnase. Avant d’asséner le coup fatal à sa victime, Myers était abattu par le policier, et tombait du haut de la tour. Quelques instants après, alors que les personnages redescendaient de l’édifice, le croquemitaine réapparaissait soudain, avant d’être à nouveau réduit à néant à coup de feu par Kinkade. Ce dernier, en ôtant le masque du tueur, découvrait alors le copycat magicien Cain, soufflant les mots « Impressionant, hein ? J’ai fait disparaître Michael… » avant de mourir. Le véritable Myers, usant de cet énième subterfuge après sa chute pour s’évaporer, laissait ainsi à la production le soin de surfer sur une nouvelle suite selon le succès de cet épisode.
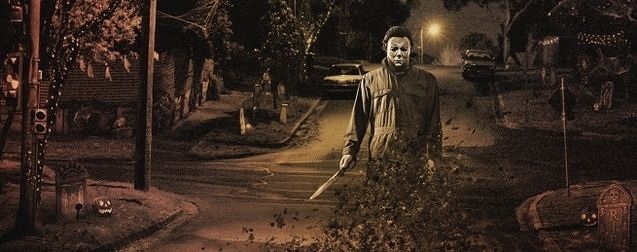
Bien que le projet ait rapidement été abandonné suite au succès de Scream qui a relancé l’intérêt du public pour le slasher, l’ébauche de cet Halloween 7 : two faces of evil est toujours consultable en ligne. Parmi les idées les plus originales et amusantes de ce scénario, on peut noter la lourde artillerie sécuritaire de la prison de Middle Rock, qui est allée jusqu’à implanter une balise GPS dans la cheville de Myers pour pouvoir le retrouver par liaison satellite. Le script faisant suite à Halloween 6, des informations sont également données sur l’enfant de Jamie, adopté par une famille dans un autre état. L’inspecteur Kinkade considère même un temps que cet enfant puisse être la prochaine victime de Myers. Cain apporte alors ses propres théories sur les raisons de tuer de Michael Myers, aux antipodes des recherches du Dr Loomis, de l’idée de la malédiction familiale, ou des faits liés à la secte de Thorn étalée dans le sixième film. Selon lui, il ne s’agit que d’une attraction sexuelle pour ses victimes, expliquant le fait qu’il les épie, les suit, s’approche inexorablement d’elles. Mais cette quête se solde par la libération de toutes ses frustrations à ne pas savoir comment s’y prendre, une âme de petit garçon dans un corps d’adulte qu’il ne maîtrise pas, et son aura malfaisante finit par le conduire à les assassiner. Indirectement, et comme tentera de le faire la dernière trilogie à partir de 2018, Michael redevient alors le croquemitaine d’origine, frappant au hasard, sans lien direct avec telle ou telle victime. Une menace fantomatique et constante. « He’s the boogeyman » , annonce sobrement Cain.

Notre bon vieux croquemitaine gratifie le script de ses nombreuses apparitions/disparitions et jeux de chat et de la souris comme on le connaît (notamment lors d’une séquence d’un rêve où l’inspecteur regarde des bobines de vieilles vidéos de famille des Myers, projetées sur un écran blanc. Le croquemitaine surgit soudainement de la toile pour trancher la gorge du policier, alors que le projecteur superpose l’image de Myers enfant sur le masque du tueur). Il s’adonne également à quelques meurtres originaux, lâchant par moments son couteau au profit d’un crâne coupé à la scie, une noyade dans une piscine ou une asphyxie avec le chapeau d’un costume de préservatif (la magie d’Halloween). Il ira même jusqu’à revêtir une cape d’un déguisement de comte Dracula pour duper une jeune fille croyant avoir affaire à son petit ami, avant un empalement/pendaison dans une cuisine se soldant par l’image de Myers admirant le fruit de son travail. Indiscutablement, cet Halloween 7 a le mérite de proposer quelque chose de nouveau, respectant les films originaux sans les citer, ouvrant le champ à de nouvelles possibilités, et exposant surtout une nouvelle palette de personnages intéressants, dont le copycat qui a plus d’un tour dans sa manche. Lorsque la participation de Jamie Le Curtis a fini par transformer totalement le projet, le script d’Halloween 7 : two face of evil n’a pas complètement disparu au premier abord, puisqu’au-delà de quelques lignes de dialogues conservées pour le film final, l’enquête policière de Kinkade devait servir de film rouge à H20 (via un personnage interprété par Charles S. Dutton [Mimic, Gothika], calqué sur le Dr Loomis ; intervention au bout du compte limitée au rôle dont Beau Billingslea écope dans la scène d’intro définitive du film, après le meurtre de Marion), tout comme l’idée d’un copycat sur le campus qui elle aussi est restée un temps dans le scénario d’Halloween H20, avant que le film ne revienne, façon « back to the basics » , à la forme qu’on a découvert finalement à sa sortie en août 1998.